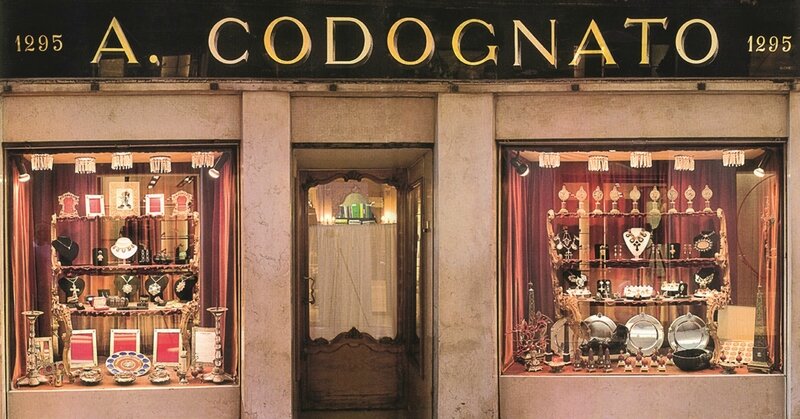«Globalement, la situation des papillons de jour ne s’est pas améliorée au cours des vingt dernières années.» Yannick Chittaro est spécialiste des lépidoptères. Il travaille au Centre suisse de cartographie de la faune (CSCF), à Neuchâtel et a coordonné la réactualisation de la Liste rouge, qui datait de 1994, consacrée à ces insectes. Sur les 226 espèces évaluées, 78 figurent désormais sur la Liste rouge établie selon les critères de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). Cela signifie qu’un tiers des espèces indigènes de papillons de jour et de la famille des zygènes sont menacées en Suisse. Quarante-quatre espèces, soit un cinquième, en réchappent juste, mais sont considérées comme «potentiellement menacées».
«En créant, mon frère et moi, le site www.lepido.ch, en 2011, nous avons voulu encourager M. et Mme Tout-le-monde à observer les papillons de jour en Suisse. Les papillons méritent la même attention que les oiseaux, qui font l’objet de nombreux relevés », explique Michel Baudraz ingénieur spécialisé en environnement et actuel directeur du bureau exécutif de l’association de la Grande-Cariçaie. En effet, ces insectes sont dotés d’un fort capital sympathie. Ils permettent de sensibiliser les gens à la nature et sont de très bons indicateurs de l’état de la biodiversité. «Dans un milieu favorable, on relèvera très facilement une vingtaine d’espèces, tandis qu’au centre d’une zone agricole cultivée intensivement, il n’y en aura aucun, précise-t-il. Les papillons se déplacent peu et vivent dans de petits territoires. Leur présence est très visible et très symbolique.»
Ecosystèmes menacés
Cause principale de leur raréfaction: la disparition des milieux naturels qui leur sont favorables. «En Suisse, on trouve des papillons jusqu’à 3000 mètres d’altitude et certains même en milieu urbain. Toutefois, les milieux qui leur sont le plus propices sont les prairies sèches et extensives bordées de haies et de lisières. Les zones humides et forestières hébergent moins d’espèces, mais celles-ci sont souvent très spécialisées, comme le grand mars changeant qui ne pond que sur le saule marsault. Résultat: elles sont menacées dans une proportion encore plus forte», souligne le spécialiste. L’intensification de l’agriculture, l’urbanisation, le développement des infrastructures de transport ont notamment réduit ces zones comme peau de chagrin, sur le Plateau et à basse altitude surtout. Les milieux alpins restent relativement mieux préservés. Pourtant, des mesures ont été prises, il y a plusieurs dizaines d’années déjà. L’initiative Rothenthurm a amélioré la protection des tourbières, des hauts et bas-marais dès 1987. L’inventaire fédéral des prairies et pâturages secs, entré en vigueur en 2010, prévoit des mesures de protection, la politique agricole a depuis 1993 instauré des surfaces de compensations écologiques. Ces mesurent se révèlent-elles inutiles? «Il est malheureusement beaucoup plus facile de faire disparaître une espèce que de la faire revenir, relève Yannick Chittaro. Et nous ne sommes pas encore à même d’expliquer tous les phénomènes. A l’origine assez largement répandue en Suisse, le fadet des tourbières (Coenonympha tullia) a connu un recul dramatique, sans qu’on puisse totalement l’expliquer», admet Yannick Chittaro.
Les gagnants et les perdants
Si les perdants sont nombreux, il y a tout de même des gagnants. Pour quatre ou cinq espèces, la situation s’est améliorée. Par le passé cantonné en Valais, le nacré de la ronce (Brenthis daphne) étend actuellement son aire d’occupation au Plateau, sa plante hôte y étant très répandue. Les populations d’azuré du trèfle (Cupido argiades) s’étendent elles aussi. Peut-être à la faveur du réchauffement climatique, qui limite la mortalité hivernale. Certains papillons, comme le collier de corail (Aricia agestis), font preuve d’une remarquable faculté d’adaptation. En diversifiant leurs sources de nourriture et en multipliant leurs plantes hôtes, ils augmentent aussi leurs chances de survie. Car ce sont les espèces très spécialisées qui sont le plus en danger. Certaines exigent, pour se reproduire, des conditions écologiques d’une complexité remarquable. C’est notamment le cas pour les azurés des mouillères, du serpolet ou des paluds (Maculinea spp.) Ils ne pondent leurs œufs que sur les plantes qui sont à même de nourrir leurs jeunes chenilles, à savoir, respectivement, la gentiane des marais, le thym serpolet et la sanguisorbe officinale. Mais ce n’est pas tout. Après quelques semaines, les chenilles se laissent tomber sur le sol et doivent, pour continuer leur développement, être récupérées par des espèces spécifiques de fourmis. Transportées dans la fourmilière, elles y hivernent, tout en poursuivant leur croissance. Elles se transforment en nymphes à la fin du printemps, avant de prendre leur envol. Avec cet exemple, on comprend bien la difficulté d’intervenir pour restaurer des conditions naturelles dont l’extrême spécificité repose sur un équilibre fragile.
Les Listes rouges permettent à la Suisse de savoir où elle en est au niveau de la conservation des espèces puis d’émettre des recommandations quant aux mesures à prendre pour les préserver. 93 papillons de jour et zygènes sont ainsi inscrits sur la Liste des espèces prioritaires au niveau national. Certains font l’objet de plans d’actions spécifiques comme c’est le cas pour les azurés des paluds. Les recommandations concernant la fauche, la pâture, la plantation de certaines espèces de plantes ou l’aménagement de milieux favorables sont indispensables et porteuses de résultats tangibles. Elles restent cependant parfois difficilement conciliables avec nos exigences de productivité et notre amour du «propre en ordre».
Marjorie Born
Terre&Nature, le 3 avril 2014
Des mesures concrètes pour les préserver
La plupart des papillons ne sont pas de grands voyageurs. Des milieux relativement restreints leur suffisent pour se nourrir et se reproduire. En ce sens, mieux vaut multiplier les petits recoins offrant des conditions variées. Au jardin, on peut planter une haie naturelle, laisser un bout de talus en friche, opter pour le gazon ou la prairie fleuris, laisser pousser un roncier, préserver le lierre, garder quelques plantes d’ortie, entasser du bois ou des pierres dans un coin, construire un mur de pierres sèches, planter quelques arbres fruitiers ou opter pour une toiture végétalisée. Le tout en abandonnant les produits phytosanitaires et en portant son choix sur des méthodes de cultures biologiques. A la campagne, les paysans reçoivent, dans le cadre de la politique agricole 2014-2017, des contributions à la biodiversité pour aménager des surfaces de haute qualité écologique comme les jachères, les friches et les chemins en terre ou pour en retarder la fauche des prairies. Ils peuvent également se regrouper pour créer des réseaux écologiques afin de limiter l’isolement des populations de papillons et favoriser leur brassage génétique.
+ d’infoswww.lepido.ch, www.ofev.ch, www.oqe.ch
Lépidoptères sous la loupe
- Habitat 80% des espèces de papillons diurnes sont directement liées aux surfaces agricoles.
- Envergure Le grand sylvain, avec une envergure de 75 à 95 mm, est le plus grand papillon indigène. L’argus frêle est l’un des plus petits avec 18 à 22 mm d’envergure.
- Hivernage 5 mois. C’est le temps, d’octobre à février, que le citron peut passer, sur une tige, pratiquement sans bouger. Il hiverne grâce à un antigel qu’il produit lui-même.
- Migrations Jusqu’à 5000 kilomètres! C’est la distance que parcourent la vanesse des chardons et le vulcain. Ils migrent depuis l’Europe, pour passer l’hiver en Afrique du Nord. Leur vitesse moyenne est de 25 km/h.
- Durée de vie 2 à 3 semaines. C’est la durée de vie moyenne des papillons de jour adultes, hormis les citrons et les paons du jour, qui hivernent.
+ d’infos Centre suisse de cartographie de la faune (CSCF), www.cscf.ch